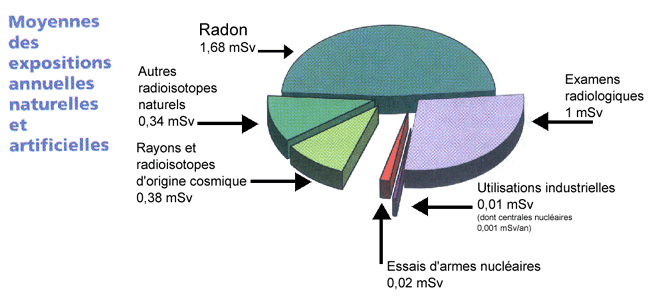Comment ça marche ?
La radioactivité
Un phénomène naturel
La radioactivité n’a pas été inventé par l’homme.
C’est un phénomène naturel. Il existe dans la nature une cinquantaine
d’atomes dont le noyau peut se modifier spontanément et émettre
des rayonnements ionisants (alpha, bêta, gamma), c’est-à-dire de
la radioactivité. Ces atomes portent ainsi le nom de radioéléments
ou encore de radionucléides.
Principe
Certains isotopes sont instables car les neutrons et les protons qui composent
leur noyau ne parviennent pas à trouver un équilibre. Ils vont
chercher à devenir plus stables en libérant leur trop plein d’énergie
sous forme de rayonnements. On dit qu’ils se désintègrent c’est-à-dire
qu’ils se transforment en d’autres isotopes. C’est le phénomène
de la radioactivité.
Il existe trois types de rayonnements : a
, b , g .
a Û éjection
en une seule fois de 2 neutrons et 2 protons
b Û éjection
d’1 électron
g Û formé
de photons, grain d’énergie sans masse
Origine des rayonnement ionisants
|
Naturelle
|
Artificielle
|
|
Cosmique : les étoiles, le soleil,
sont des " réacteurs nucléaires "
émettant des rayonnements plus ou moins absorbés par
l’atmosphère, d’où une irradiation plus élevée
en altitude.
|
Utilisation médicale : radiographies, et traitement
radiologiques
|
|
Tellurique : la terre contient depuis sa création
des éléments radioactifs qui se désintègrent
progressivement en émettant des rayonnements et en produisant
d’autres éléments radioactifs (radon)
|
Retombées des essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère.
|
|
Organique : le potassium 40 (produit lors
de la formation de la terre) est présent dans le corps humain
en équilibre avec le potassium organique.
|
Industrielle : industrie nucléaire, contrôle
radiographique des soudures, irradiateurs pour la conservation des
aliments,…
|
| |
centrales nucléaires : l’irradiation est essentiellement
due aux rejets radioactifs en fonctionnement normal.
|
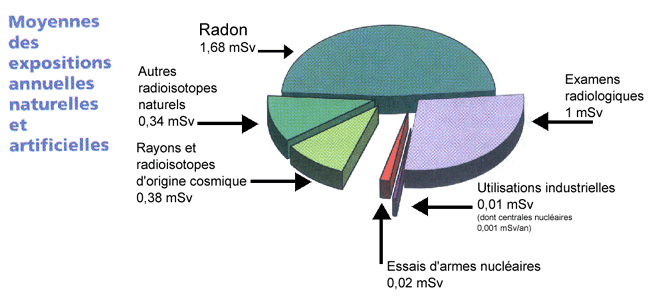
Le parcours des rayonnements
En traversant la matière, les rayonnements rencontrent des atomes, sont
freinés et finissent par s’arrêter. Mais les rayonnements alpha,
bêta et gamma sont très différents et n’ont pas le même
pouvoir de pénétration, que ce soit dans l’air, l’eau, le métal,
le bêton… ou les tissus vivants.

La mesure de la radioactivité
L’activité d’une source représente le nombre d’atomes radioactifs
qui se transforment par seconde.
Ex : lait a une activité de 50 Bq par kg (activité très
faible et naturelle)
Tout point de contamination supérieur à 1 milliard de Bq constitue
un incident significatif.
|
Grandeur
|
Définition
|
Unités actuelles
|
Anciennes unités
|
|
Activité
|
Nombre de désintégration par seconde
|
Becquerel (Bq)
|
Curie (Ci)
1 Ci = 37.109 Bq
|
|
Dose absorbée
|
Quantité d’énergie par unité
de masse irradiée
|
Gray (Gy)
|
Rad
1 Rad = 0,01 Gy
|
|
Equivalent dose
|
Effets des rayonnements sur l’organisme
|
Sievert (Sv)
|
Rem
1 Rem = 0,01 Sv
|
Les modes d’exposition
Une personne soumise à des rayonnements subit une exposition dite externe
si la source de rayonnement est extérieure à l’organisme. En revanche,
on parle d’exposition interne si la source de rayonnement est à l’intérieur
du corps, suite à la pénétration des radioéléments
soit par ingestion soit par inhalation soit par blessure, brûlure ou passage
à travers la peau.
L’effet des rayonnements sur l’organisme humain
Fonctionnement des cellules vivantes
La cellule, unité de base de l’organisme, présente
la propriété de fonctionner de façon automatique et de
se reproduire au bout d’un certain temps, ceci grâce à la présence
dans le noyau de la cellule d’un "ordinateur" composé
d’une molécule d’acide désoxyribonucléique (ADN).
En cas de lésion, des systèmes réparent
les lésions quelle qu’en soit la cause. Le système de réparation
le plus important est fidèle, sans défaillance.
Les différents mécanismes de réparation
jouent un rôle fondamental car la molécule d’ADN est fragile, soumise
à des remaniements constants et victime d’agressions multiples (produits
chimiques, tabac, alcool, … et rayonnements ionisants).
Conséquences de l’irradiation des cellules
Le corps humain est constitué essentiellement d’atomes
d’hydrogène, d’oxygène et de carbone. Les rayonnements agissent
sur les atomes des molécules qui constituent la matière vivante,
ce qui peut provoquer des lésions dans les cellules de l’organisme. Les
conséquences dépendent de la partie atteinte de l’organisme, de
la nature du rayonnement et de son énergie, de la dose absorbée
(quantité d’énergie absorbée par kg de matière).
Les rayonnements ionisants, comme les autres agressions, peuvent
provoquer des altérations de l’ADN.
Trois cas de figures sont possibles :
- la lésion est bien réparée : la cellule redevient
normale ;
- la lésion est irréparable : il y a mort cellulaire.
- Si le nombre de cellules mortes est faible : il y aura "
restauration " , production de nouvelles cellules (sans conséquence).
- Si le nombre de cellules mortes est important : la restauration
est impossible : apparaissent alors des brûlures, stérilités,
cataractes, éventuellement mort pour des doses très élevées.
- les lésions sont mal réparées, et les cellules survivent :
- Le dédoublement de l’ADN est bloqué, il n’y a plus de renouvellement
cellulaire (sans conséquence)
- Le système immunitaire supprime ces cellules (sans conséquence)
- La structure de l’ADN est modifiée. L’ADN continue à se
dédoubler donnant des descendance anormales (seul cas de risque de
cancers ou d’effets génétiques).
La décroissance de la radioactivité
La radioactivité diminue avec le temps. Au fur et à
mesure que se produisent les désintégrations, l’activité
d’une source décroît jusqu’à devenir nulle.
Cette décroissance de l’activité d’une source se mesure par la
période T, durée à l’issu de laquelle la radioactivité
de cette source est divisée par 2.
Chaque isotope a sa propre période de décroissance . Elle peut
aller de quelques microsecondes à plusieurs millirads d'années
|
Isotopes à période courte
|
Isotopes à période longue
|
|
polonium : 164 microsecondes
oxygène 15 : 2 minutes
iode 131 : 8 jours
cobalt 60 : 5 ans
césium 137 : 30 ans
|
carbone 14 : 5 700 ans
plutonium 239 : 24 000 ans
uranium 235 : 710 millions d’années
potassium 40 : 1,3 milliard d’années
uranium 238 : 4,5 milliards d’années
|